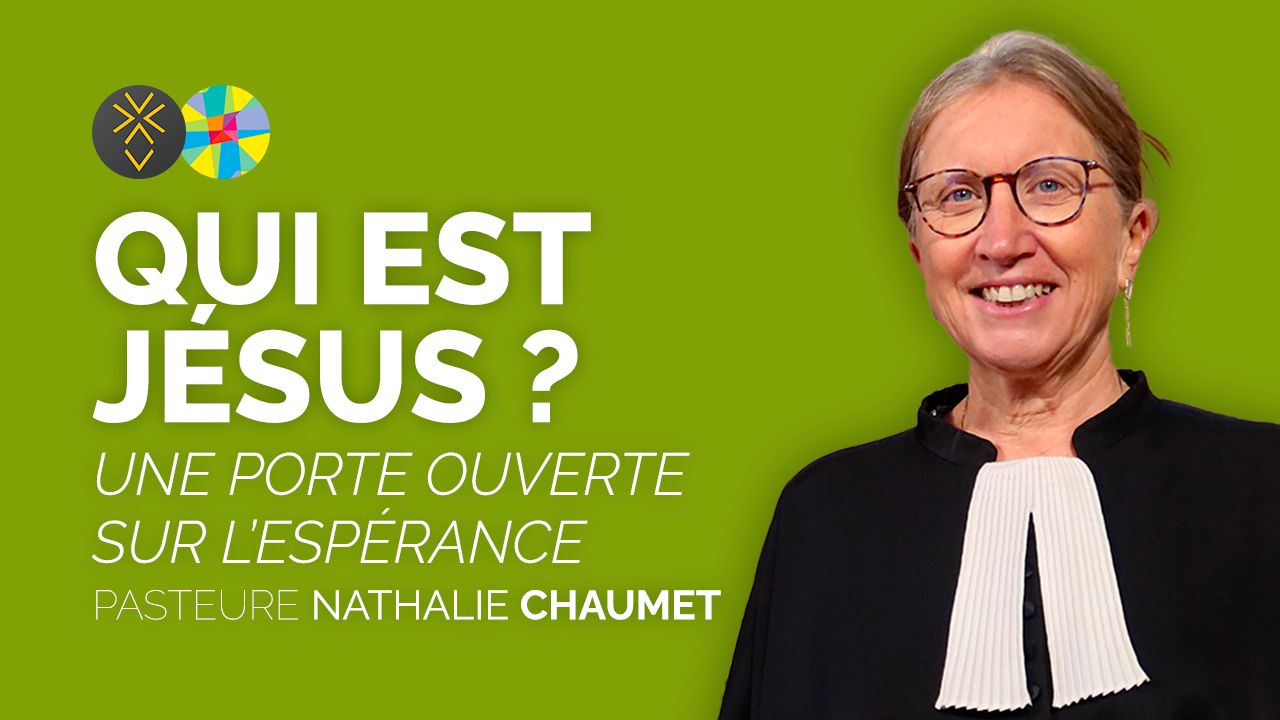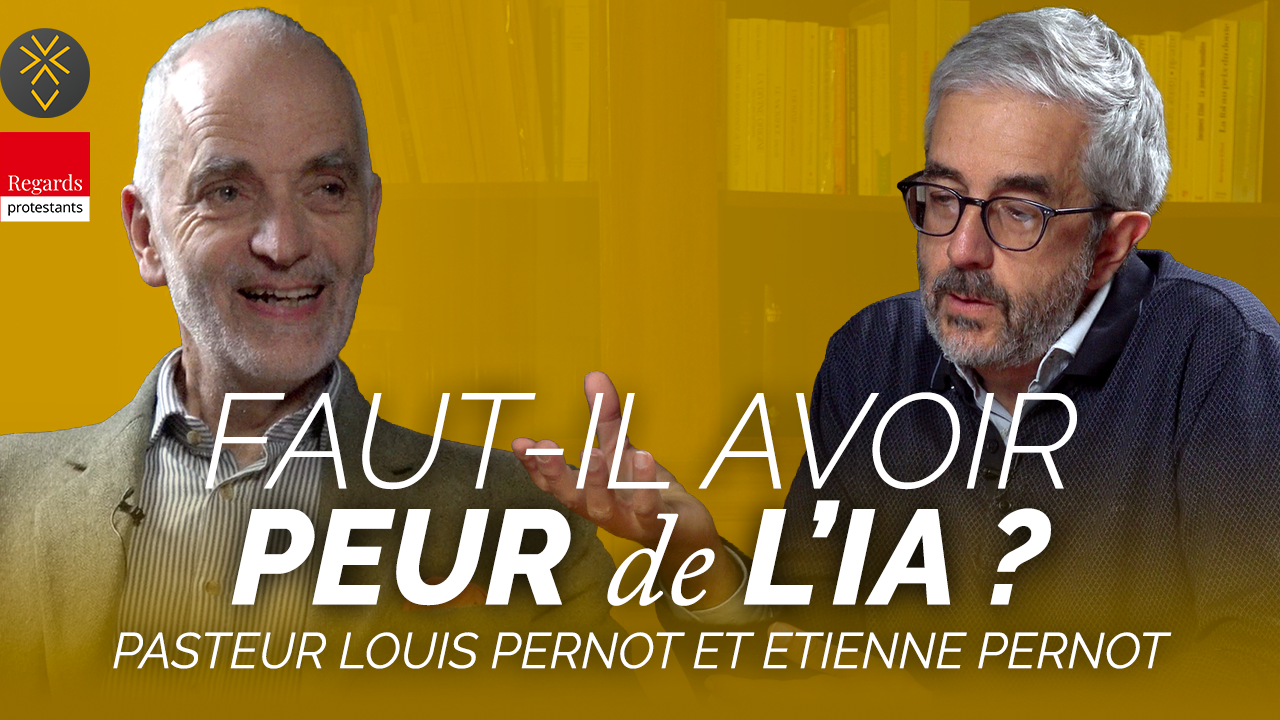Dans cette méditation sur la parabole du fils prodigue, le pasteur Louis Pernot nous invite à une lecture renouvelée de ce texte majeur de l'Évangile de Luc. À travers sept questions, il explore les dimensions psychologiques, théologiques et symboliques de ce récit familier, tout en nous réservant une énigme finale inattendue sur la signification des caroubes. Accompagné de June Kim-Legave, il dévoile notamment une fascinante connexion avec Jean-Baptiste, enrichissant notre compréhension de la repentance et de la renaissance spirituelle. De la jalousie du fils aîné à la posture du père, en passant par la symbolique du veau gras, cette analyse minutieuse offre un éclairage contemporain sur les thèmes universels de la liberté, du pardon et de la joie en Dieu.
Sept questions sur le fils prodigue (et ses caroubes)
La parabole du fils prodigue en Luc 15 : 11 à 32 est un texte des plus connus et des plus beaux de l'Evangile. Mais en même temps, comme beaucoup de paraboles, ce texte pose énormément de questions. Il y en a en particulier une que j'essaie de résoudre depuis plus de 30 ans. Je n'ai jamais réussi jusqu'à ce que je m’y attelle enfin sérieusement, et j’ai donc quelques pistes que je voudrais partager. Voici donc sur la parabole du fils prodigue, sept questions... et la dernière va vous étonner.
1. Un des plus beaux textes de l’Evangile
Première question : pourquoi ce texte est-il peut-être le plus beau de l'Evangile ?
Oui, c'est certainement le cas. La parabole du fils prodigue est une véritable illustration de la bonne nouvelle de l’Evangile. On y a cette image du père, qui est donc Dieu, accueillant ce fils à bras ouverts, sans question, sans reproche, juste avec un amour inconditionnel et une joie totale. Certes, ce fils s'est un peu égaré, comme parfois nous nous égarons aussi. Le père a d’abord laissé le fils partir, en le laissant totalement libre, en respectant son choix, mais sans jamais ni l’oublier ni le renier. Quand le fils revient, il court même à sa rencontre, sans attendre qu’il soit entièrement revenu, il ne lui laisse même pas dire toute la confession de péché qu’il avait prévue de prononcer, et juste se réjouit de ce fils perdu et retrouvé. Ce Dieu qui nous laisse libre et qui est un Dieu d’amour inconditionnel, de grâce, d’accueil, de bonté, de générosité et de joie, c’est certainement une image la plus radicale qui soit de ce Dieu annoncé par Jésus Christ, et celui dans lequel nous voulons mettre notre foi, notre confiance et que nous aimons.
2. La jalousie du frère aîné
Deuxième question, le fils aîné, a-t-il raison d'être jaloux ?
En effet, le fils aîné n’est pas content, le texte le dit, il est jaloux, furieux qu'on fasse la fête pour son cadet qui est revenu. On peut le comprendre, mais je ne le défendrai pas ! Certes, il pouvait avoir des raisons d'être jaloux, mais d’abord, ça n'est jamais une bonne idée d'être jaloux, ça ne rend pas heureux. Et il se prive lui-même de la fête. Il se plaint de ne pas avoir de fête, mais quand il y en a une, il n’y va pas ! C'est sa jalousie qui l'empêche d'être heureux.
Et en fait, ce fils aîné est plutôt antipathique. Certes, il n'a jamais fait de mal, mais il voit tout à partir de lui. il pense que tout lui est dû, il fait des reproches à Dieu, en lui disant qu’il aurait dû faire ceci ou cela, ou qu’il aurait mérité que Dieu le félicite ou le récompense. Mais le père ne distribue de récompense à personne ! Le fils aîné ne fait rien de mal, mais il ne fait rien de bien non plus. Il ne pense qu'à lui, il n'en a rien à faire de son frère. Pourquoi n'est-il pas allé le chercher ? Pourquoi n'a-t-il pas essayé de le dissuader de partir ? Et il n’est même pas capable de se réjouir que son frère revienne, ni qu’il arrive du bien à un autre. Donc il ne fait rien de mal, mais fait rien de bien non plus. D’ailleurs, le père ne lui reproche rien, le fils aîné, n’a manqué de rien... mais si en fait, il lui a manqué juste une chose : c'est la joie. Et voici : quand on est seulement dans le devoir, dans l'exigence, dans le jugement, quand on ne regarde que ce qui est dû, ce qui est payé, ce qu'on devrait avoir, peut-être qu'on ne fait pas de mal, mais il n'y a pas de joie. Le seul chemin de la joie, c'est d'être dans la grâce, et pas dans le jugement, c'est d'être dans la générosité. Finalement, ce fils aîné est simplement l'image des pharisiens que critiquait Jésus, pleins d’exigences, de satisfaction d’eux-mêmes, de bonne conscience et de jugement des autres. En tout cas donc, non, ce fils est né n'est pas sympathique.
3. Le père attend et accueil, mais il ne va pas chercher son fils.
Troisième question : pourquoi le père ne va-t-il pas chercher son fils perdu ? Alors que dans la parabole de la brebis perdue qui précède dans l’évangile de Luc, le berger va concrètement rechercher cette brebis, il n’attend pas qu’elle revienne, il va la chercher et s’engage entièrement pour la retrouver. Mais dans notre parabole, le père, certes, accueille le fils prodigue qui revient, mais il ne va pas le chercher. Pourquoi donc ?
Peut-être que la situation n’est pas la même. La brebis égarée était « perdue », elle n’avait pas fait exprès, elle s’était égarée, et donc le berger va la chercher. Le fils prodigue, il n’est pas perdu, il a voulu lui-même s'en aller, c’est sa volonté. Et Dieu ne s'oppose pas à la volonté de quelqu'un et ne va jamais chercher quelqu'un de force. Mais ce qui est vrai, c'est que quand le père voit le fils arriver de loin, il court à sa rencontre, iln'attend pas que le fils vienne jusqu'à lui, se jette à ses pieds pour demander pardon. Il ne lui laisse même pas le temps de dire la phrase qu'il avait bien prévue. Ainsi, Dieu ne nous force en rien, mais il espère et attend simplement avec amour qu'on aille vers lui, et il est capable de faire de lui-même une grande partie du chemin dès qu’il aperçoit un signe de volonté de retour. Cela fait partie de la bonne nouvelle, Dieu nous donne, d’une part une liberté totale, d’autre part aussi un accueil inconditionnel.
4. Une résurrection cachée
Quatrième question : lorsque le fils prodigue et revenu, pourquoi le père dit-il « mon fils était mort et il est revenu à la vie » ? C'est une expression étrange : il n'était pas mort en vrai. De quoi s’agit-il et que veut-il dire ?
C'est vrai que c'est curieux. Le père dit, « mon fils était mort et il est revenu à la vie », il s’agit donc d’un texte de résurrection. Cela montre que la résurrection n'est pas simplement pour ceux qui sont morts physiquement ou pour le jugement dernier. La résurrection est une réalité qui nous concerne nous aujourd'hui, dans notre vie, parce qu’on peut vivre biologiquement mais ne pas avoir une vie pleine et entière. Et précisément, au début du texte, il est dit que le père partage son « bien ». Or, le mot utilisé ici est le mot grec « bios » qui signifie certes le « bien », mais avant tout la « vie » biologique. Et à la fin, quand le fils revient, le père dit « mon fils est revenu à la vie », et cette fois, nous n’avons plus le mot « bios », mais « zoé » qui, en grec, désigne la vie d'une façon beaucoup plus pleine et entière. Ainsi, le fils au départ a la vie biologique. Il veut considérer qu’elle lui appartient et qu’il est maître d’en faire ce qu’il veut, il va vivre en effet matériellement, en dépensant son argent. Finalement, il va vivre comme un porc. Certes, il n'est pas mort physiquement, mais intérieurement, cette vie ne va pas le mener à grand-chose et il ne découvrira la vraie vie qu’à la fin.
Or, de même que la vie biologique ne mène à rien d’autre que la mort, ne vivre que matériellement, biologiquement, comme le fils prodigue, ne mène qu’au manque, au manque de tout et aussi au manque de sens. Et le fils prodigue va découvrir un vrai sens de la vie. Sens qui n’est pas de consommer comme un cochon qui mange des caroubes, pas de vivre pour soi, mais de vivre au service de quelque chose et de quelqu'un qui est plus grand que soi. Il va découvrir que la plus belle chose que l'on puisse faire, le vrai sens de la vie, ce n'est pas de consommer, mais de servir. Servir son prochain certainement, et là dans la parabole, servir le père, c’est-à-dire Dieu. Or Dieu, c’est l'amour, la fraternité, la paix dans, la générosité, la gratuité, le don. Voilà ce qui est vraiment vivre : mettre sa vie au service de ces valeurs qui sont plus grandes que soi, alors on se trouve comme aspiré dans une dimension qui est au-delà de l'animal et au-delà du bios pour arriver à la zoé, la vie. Découvrir cela peut être une forme de résurrection parce que ça change la vie. C'est vraiment vivre pleinement et c'est aussi ce qui mène, comme le fils prodigue quand il revient, non seulement à la vie, mais à la joie et à la fête.
5. Faut-il être débauché pour découvrir l’amour de Dieu ?
Dans ce sens-là, voici la cinquième question : faut-il nécessairement avoir vécu dans la débauche comme le fils prodigue pour découvrir l'amour de Dieu ?
Cette question est en effet embarrassante, la parabole peut donner l'impression que si l’on veut imiter le fils prodigue, alors il faudrait aller voir les prostituées, dépenser tout son argent et se rabaisser au niveau des porcs. Mais moi, je n'ai pas fait tout ça, je n’ai jamais été débauché... Ai-je alors une chance de découvrir l'amour de Dieu ? D'une certaine manière, je suis plus comme le fils aîné, j'ai toujours à peu près tout bien fait dans ma vie et resté fidèle à Dieu sans chercher à m’en éloigner. Cela m’exclue-t-il de fait de la vie et de la joie que l’on nous montre au retour du fils prodigue ? Et les enfants qui n’ont jamais été bien pécheurs seraient-ils privés de la grâce de Dieu ? Bien sûr non ! Le fils prodigue n’est pas un modèle à imiter, son histoire dit simplement une chose, c’est que pour découvrir l'amour de Dieu, il faut à un moment donné faire l'expérience du manque, découvrir qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans sa vie.
Cela est évidemment plus facile pour ceux qui ont un certain âge. En prenant de l’âge, on découvre petit-à-petit que les joies terrestres sont limitées et que finalement, elles ne mènent pas forcément à une grande satisfaction. Il est donc normal qu'il y ait plus de vieux que de jeunes dans les églises. Mais cela ne veut pas du tout dire que les jeunes seraient exclus du processus de découverte de l’amour de Dieu. Il n’est pas du tout obligé d'être vieux ou d'avoir vécu une mauvaise vie pour pouvoir découvrir la grandeur de la grâce de Dieu et de cette présence qui nous accueille. L'expérience montre que l'enfance est souvent un moment où l’on peut être très proche de Dieu, il y a en effet des enfants qui peuvent avoir une foi spontanée extraordinaire. Des enfants peuvent sentir qu’il y a un Dieu qui les aime et auquel on peut parler. Et même ensuite, entre 18 ou 30 ans n’est pas du tout un âge d’impiété. C’est même l’âge de la vocation, l’âge où certains s’engagent pour Dieu, pour la foi, pour l’Eglise. C'est un âge extraordinaire où l’on peut découvrir vraiment, non seulement toute la grandeur de l'amour de Dieu, mais aussi comprendre intellectuellement toute la profondeur du message évangélique et de la théologie. Et à cet âge, la foi peut avoir un caractère déterminant, parce que c’est le temps des choix de vie, des orientations, des engagements qui feront toute une vie. Donc, non, il n'est pas nécessaire d'être vieux, d'avoir bourlingué et d'être revenu de tout pour découvrir qu’en Dieu, enfin, il y a de la joie et un sens à la vie.
Par ailleurs, même les enfants peuvent expérimenter la finitude et le besoin de revenir dans les bras de Dieu. La vie des enfants est souvent idéalisée par les adultes qui imaginent que ce n’est que joie et insouciance, mais c’est faux, être un enfant, ce n’est pas facile du tout. Les enfants ne sont satisfaits de tout ce qui leur arrive. Dans la vie d'un enfant, il y a beaucoup de frustrations, de contrariétés, de déceptions, de tristesse même. Les enfants comme les jeunes et les adultes peuvent être confrontés à l'échec, un enfant, peut se sentir incompris, et un enfant, ça fait des bêtises, il se fait juger, il se fait gronder, à l’école il a peur d’avoir de mauvaises notes... et il en a, il peut se faire punir, il peut aussi être rejeté par les autres, voire harcelé, victime de violence, d’exclusion. Donc il ne faut pas croire que la vie d’un enfant soit si facile que cela. Et même quand on est enfant et quand on est jeune, on peut expérimenter le manque et la peur. Certes, normalement un jeune ne manque pas de bonne santé, mais il peut avoir peur de manquer, au moins dans l’avenir. Peur de ce que sera le monde demain, peur de ne pas trouver le bon métier, de n’avoir pas de moyens ou d’argent, ou de ne pas parvenir à trouver un conjoint, à créer une famille. Peur de perdre ce que l’on a en ce moment, de perdre le pays qu’on a connu et aimé. Donc il peut y avoir beaucoup de manque, d’angoisse, de frustration rendant même nos jeunes infiniment proches de l’enfant prodigue. Et donc même un jeune, sans aller se débaucher avec les prostituées, expérimente ce qui est symbolisé là par le fils prodigue. Et ainsi vouloir aller chercher auprès de Dieu tout ce qui manque dans ce monde, et que la vie matérielle ou la situation concrète, ou les autres ne sont pas en mesure de donner. Parce qu’auprès de Dieu, on peut découvrir une plénitude, auprès de Dieu, on peut découvrir un amour qui, lui, ne vous blessera jamais. Auprès de Dieu, on a un ami qui nous comprend et à qui on peut parler. On peut tout dire à Dieu dans la prière, et lui, il nous comprend lui, il ne nous gronde pas, ne nous angoisse pas, mais au contraire, il nous accompagne, il nous suit, il nous parle, il nous encourage et nous reçoit à bras ouverts. Et dans la présence de Dieu, on peut avoir tellement de joie et de choses qui nous réconfortent. Donc oui, effectivement, même sans être débauché, évidemment, et à tout âge, on peut découvrir qu'avec Dieu, on peut tout avoir en abondance.
6. Pourquoi tant d’insistance sur le « veau gras » ?
Sixième question : pourquoi le texte insiste-t-il tellement sur cette histoire de « veau gras » quel rôle joue-t-il vraiment dans cette histoire ?
Il y a là une petite facétie... Une question semblant humoristique que posait avec humour chaque fois un de nos chers moniteurs d’école biblique aujourd’hui prématurément décédé : Jean Evesque. Et donc chaque fois que l’on présentait cette parabole aux enfants il demandait : « si le fils aîné avait tort de ne pas se réjouir du retour de son frère, qui dans l’histoire est le seul qui avait de bonnes raisons de ne pas se réjouir du retour de l’enfant prodigue ? Réponse : le veau gras ! (Puis qu’il allait être sacrifié pour faire la banquet).
Mais la question n’est pas si ingénue : pourquoi le texte insiste-t-il à plusieurs reprises pour évoquer ce « veau gras », ce « veau engraissé ». Que vient-il faire dans cette histoire ? La Bible ne parle jamais pour ne rien dire.
Si l’on recherche où dans la Bible il en est question, on trouve en particulier en Jérémie 46:21 une prophétie contre les Égyptiens qui se comportent n'importe comment, et Dieu dit : « ces salariés, sont au milieu de l'Égypte comme des vaux gras, et ils se détournent, ils fuient dans tous les sens, ils ne se tiennent pas, car le jour de leur désastre vient sur eux et le temps de l'intervention de Dieu vient contre eux ». Ce passage est passionnant, parce qu’on y retrouve à la fois le « veau gras » et les « salariés » présent avec insistance dans notre parabole. (Dont le fils dit qu’ils ont du bien en abondance et qu’il veut être traité comme l’un d’eux). Le texte de Jérémie fustige ceux qui se comportent n’importe comment, ressemblant à des veaux gras qui courent dans tous les sens pour aller nulle part.
Et du coup, quand le père tue le veau gras, ce n'est pas simplement pour faire une sorte de méchoui festif, c'est que symboliquement, il va tuer cette dimension de vaux gras irresponsable qu'il y avait dans ce fils prodigue qui se comportait en effet comme un veau engraissé. Ce veau gras est l'image du mauvais côté du fils prodigue. Le père en accueillant son fils annule l'idée qu'il soit veau gras, il annule aussi l'idée qu'il soit serviteur, salarié, de son père. Il dit en fait que non seulement il n’est plus comme un veau faisant n’importe quoi et allant dans tous les sens, mais qu’il n’est même plus un salarié. Il va le traiter comme son fils. Non seulement le père accueille le fils prodigue, mais aussi grâce à l'attitude qu'il va avoir à vis-à-vis de lui, il ne va pas juste le laisser dans son tempérament débauché, mais il va l'aider à le remettre dans l'ordre, en le rétablissant comme fils, et non pas comme un veau inconséquent. C'est vraiment une nouvelle vie pour lui.
7. Pourquoi des caroubes ?
Mais voilà la septième question que vous attendiez tous ! Cette question qui me tracasse depuis des années. Certaines des interrogations précédentes sont assez connues, mais il y en a une qui est rarement posée : que vient faire dans cette histoire, cette mention des caroubes ? Le texte insiste pour dire que le fils prodigue voulait manger les caroubes qu'on donnait au porc, mais que personne ne lui en donnait. C'est curieux parce que les caroubes, en fait, personne ne sait très bien ce que c'est. Il semble que ce soit une sorte de fruit bizarre, mais il n'en est fait nulle part mention dans la Bible. Pourquoi nous précise-t-on qu’il s’agit de caroubes et pas des figues, de haricots ou de diverses graines ? Cela demande une recherche particulière. Et en creusant la question on trouve !
Certes, dans l'Antiquité, la caroube était largement utilisée comme nourriture pour le bétail. Et en période de famine, elle était ultime à l'aliment pour les pauvres. Au Moyen-Âge en Europe et au Moyen-Orient, elle était considérée comme une nourriture de survie pour les plus démunis. Mais elle peut avoir en plus un sens tout à fait symbolique.
D'abord, la caroube, en grec, cela se dit « keration » ce qui signifie « petite corne. Or la corne, « qeren » en hébreu signifie aussi le « pouvoir », la « puissance ». Voilà déjà peut être une idée : on peut penser que le fils prodigue avait un désir de puissance. Mais personne ne le nourrissait dans ce sens. Il attendait peut-être la reconnaissance des autres, mais il n’a pas été comblé. Il a eu alors une idée formidable : Il renonce à vouloir dominer les autres pour se faire serviteur. C’est une révolution qui va lui changer la vie et le ressusciter à une nouvelle existence pleine de joie.
Et puis, les caroubes, ça ressemble à un gros haricot avec des couleurs assez sombres, et l’aspect peut faire penser à une grosse sauterelle. C’est pourquoi sans doute un des noms du caroubier est l’« arbre à sauterelles ». Par ailleurs, en hébreu les deux mots « caroube » et « sauterelle » se ressemblent beaucoup, et cela a pu participer au lien entre les deux. Certains chercheurs pensent alors que peut être les sauterelles que mangeait Jean-Baptiste étaient en fait des caroubes, ce qui est confirmé par le fait que dans les premières communautés chrétiennes, les caroubes étaient appelée « le pain de Jean Baptiste », et le caroubier est encore appelé dans les milieux anglophones l’ « arbre à sauterelles ». Voilà donc Jean-Baptiste qui s’invite dans notre récit, et plus encore qu’on ne le pense, en effet, d'après la tradition juive, le Talmud dit que quand on cueillait une caroube, il y avait comme plein de miel en qui découlait. Nous sommes ainsi avec les deux nourritures de Jean Baptiste dont il est dit qu’il se nourrissait de sauterelles et de miel sauvage.
Voilà donc que ces mystérieuses caroubes nous ramènent de force à Jean-Baptiste. Or on sait que la mission de Jean Baptiste était d'inviter les gens à la repentance, c'est-à-dire à reconnaître leurs fautes, reconnaître leurs péchés, et il les plongeait dans l'eau en signe de pardon et de grâce, comme s’ils ressortaient de l'eau lavés de leur faute. On voit tout de suite que c’est exactement l’histoire du fils prodigue ! Notre parabole est bien, en effet, une histoire de péché, de repentance et de pardon. Le fils prodigue s’éloigne de Dieu, il reconnaît sa faute, et il revient vers le père, et là, il naît à une vie nouvelle, comme le baptisé Jean Baptiste était plongé dans l'eau en signe de mort pour renaître à une vie nouvelle.
Cette mention de la caroube n'est donc absolument pas faite au hasard, et une fois de plus, cela montre que même quand on croit connaître les textes, il faut toujours les regarder de près, et même un simple mot peut cacher une richesse considérable de sens.
Et puis, reconnaître son péché, ce n'est pas faire le catalogue de ses fautes, c'est reconnaître qu'il y a une imperfection en soi, reconnaître qu'on est dans l'échec, dans les difficultés, dans le manque. Et c’est ainsi que l’on peut entendre une bonne nouvelle et découvrir la grâce de Dieu, l’amour et le pardon. Comme le fils prodigue reconnaît effectivement qu'il est seul, pauvre, triste, et qu’alors il décide de retourner à Dieu, il va découvrir la grâce en allant vers son père. Celui-ci ne lui va lui faire aucune condamnation et aucun reproche, et en allant vers son père et en allant vers Dieu, le fils va découvrir une chose, c'est l'amour, le pardon et la joie en Dieu. C'est une forme de résurrection, comme nous l’avons vu, il passe de la mort à la vie, il accède à une vie nouvelle. Comme le baptisé était plongé dans l'eau et qu'il sortait comme s'il naissait de nouveau.
Et cette vie nouvelle, c'est ce qui nous est proposé à nous tous en faisant, à notre manière, ce cheminement, qui consiste premièrement à assumer notre propre liberté. Sans doute cela est-il important pour accéder à une foi adulte, et sans forcément aller se débaucher, il faut commencer par accepter d'être libre, par rapport à Dieu. Une vie spirituelle épanouie ne peut se faire dans la dépendance ou dans le fait de suivre servilement telle doctrine ou telle Eglise, mais dans un mouvement de liberté, d'autonomie et de responsabilité. Il faut pouvoir faire ses propres décisions, ses propres choix. Et après il faut reconnaître que l’on n'est pas tout seul centre de tout, que nous ne pouvons pas prétendre tout diriger, tout gouverner, en mangeant nous-mêmes les caroubes du pouvoir et les cornes de la toute-puissance, mais au contraire, il faut découvrir que le vrai chemin c'est de reconnaître son imperfection, ses propres manques, ses propres angoisses, ses propres faiblesses, et d'aller courir vers Dieu qui nous accueille à bras ouverts et qui fait une grande fête pour nous en nous mettant la plus belle des robes, en nous mettant une bague aux doigts, des sandales aux pieds et en tuant le veau gras pour nous. Vraiment, comme le fils prodigue, nous pouvons passer ainsi de la mort à la vie. Et nous en rendons grâces.