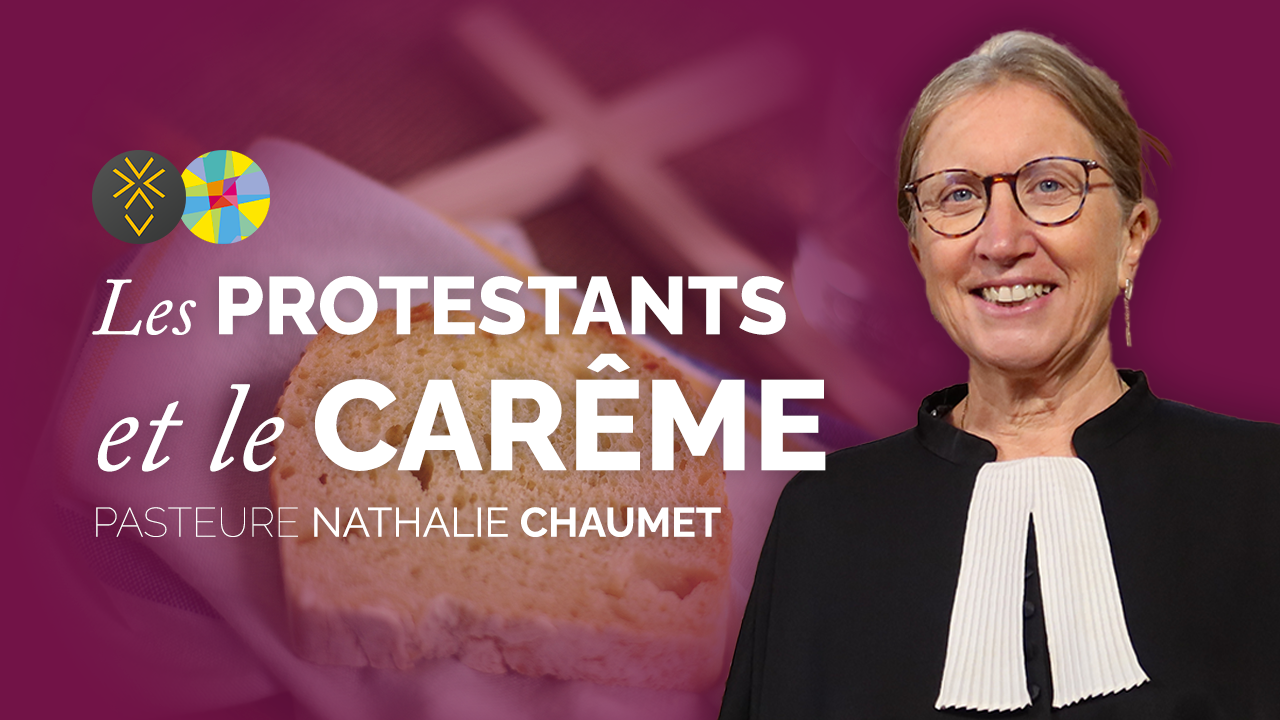Amour, mariage et mandragores : le Cantique des cantiques
11Je suis à mon bien-aimé, et ses désirs (se portent) vers moi.
12Viens, mon bien-aimé, sortons dans les champs, passons les nuits dans les villages !
13Au petit matin nous irons dans les vignes, voir si ce cep bourgeonne, si la fleur s’ouvre, Si les grenadiers fleurissent.
Là je te donnerai mon amour.
14Les mandragores donnent leur parfum,
Et nous avons à nos portes tous les fruits exquis, les nouveaux comme les anciens :
Mon bien-aimé, je les ai réservés pour toi. (Cant 7 :11-14)
Sens spirituel du Cantique des Cantiques
Voici un passage de la Bible souvent cité lors des célébrations nuptiales, tiré du Cantique des Cantiques (Cant. 7:11ss). Ce livre, l’un des plus singuliers de la Bible, parle exclusivement d’amour, et, fait remarquable, le nom de Dieu n’y est jamais mentionné. De là certains se sont interrogés sur la légitimité de sa place dans les Écritures. On peut le justifier en disant qu’il est bon que la Bible parle aussi d’amour humain, mais surtout, ce livre possède un double niveau de lecture. Dans l’ensemble de la Bible, l’union entre l’homme et la femme est présentée comme une image de la relation entre Dieu et l’humanité.
Ce double sens nous invite à réfléchir : la relation entre Dieu et l’homme ressemble, à bien des égards, à celle que l’on trouve dans un couple. Il s’agit d’entrer en relation avec un être différent, que l’on ne cherche pas à rendre semblable, mais que l’on choisit d’accueillir dans sa différence. Il y a là une dynamique de complémentarité, d’ouverture à l’autre, qui permet — au sens spirituel — une fécondité. Il ne s’agit pas ici de procréer, mais de devenir capable de donner au monde quelque chose qui dépasse notre seule individualité.
Ainsi, le Cantique des Cantiques peut se lire à la fois comme l’expression poétique de l’amour entre deux êtres humains, et comme une métaphore profonde de l’amour entre Dieu et son peuple. Notre passage commence par « Je suis à mon bien-aimé, et ses désirs se portent vers moi. » et les quelques versets qui suivent tracent en quelque sorte un programme : celui de ce que nous sommes appelés à vivre dans cette relation d’amour.
Allons dans le monde !
La première chose que l’on lit, au verset 12, c’est : « Viens, mon bien-aimé, sortons dans les champs, passons la nuit dans les villages ». Cette invitation à sortir dans les champs et à demeurer dans les villages est belle, et convient bien à une prédication de mariage ! Ben sûr, les jeunes mariés s’aiment, se regardent tendrement dans le blanc des yeux et c’est magnifique. Mais le sens profond de la vie, du mariage, et de toutes les grâces que nous recevons n’est pas de les garder pour soi, mais au contraire d’en rayonner, de les offrir, de les partager avec le monde. Ce que l’on tente de retenir égoïstement finit par se perdre. La vie, l’amour, les dons que nous recevons… tout cela trouve sa plénitude lorsqu’on les met en circulation, lorsqu’on les diffuse. Dans tous les cas il est essentiel de ne pas rester repliés sur soi, mais s’ouvrir, aller vers le monde. Et cela vaut aussi pour la vie spirituelle — puisque, je vous le rappelle, ce texte du Cantique des Cantiques porte toujours ce double sens.
Quand il est dit « sortons dans les champs », on peut s’étonner. Dans la Bible, les champs ne sont pas un lieu spirituel. Bien au contraire : ils sont souvent associés à un environnement sauvage, dangereux, le lieu des bêtes féroces. Les champs symbolisent le monde matériel, brut, non idéalisé. Et c’est justement là que l’on est appelé à aller. Cela rejoint une conviction essentielle de Réforme : la vie spirituelle ne consiste pas à se retirer du monde pour vivre à part, à prier enfermé dans sa chambre, coupé du réel. Elle nous pousse à sortir, à nous engager dans le monde.
C’est aussi la vocation du pasteur, ce qui peut surprendre ceux issus d’autres traditions religieuses, les pasteurs vivent dans le monde, et ce n’est pas une faiblesse ou une tolérance exceptionnelle qu’ils puissent vivre comme tout le monde. C’est un choix théologique fort : il est essentiel d’être immergé dans la vie réelle, de partager la condition commune.
Mais l’appel ne s’arrête pas aux champs. Il se prolonge par : « Passons la nuit dans les villages ». Les villages, eux, sont des lieux habités, des lieux de vie humaine, de société. Ainsi, à côté de l’appel à aller dans le monde, il y a cette deuxième vocation essentielle : l’attention à la relation et à la personne.
C’est une conviction que je porte profondément, notamment dans mon ministère. L’Église, la prédication de l’Évangile, tout cela doit être infiniment attentif aux personnes concrètes. Il ne faut pas écraser qui que ce soit sous le poids d’un dogme, d’un rite ou d’une morale rigide. Ce qui compte, c’est la relation, l’accueil, la rencontre. Il s’agit d’aller vers les personnes là où elles sont, dans leur réalité, leur culture, leur humanité. Je crois même que, dans bien des situations, la relation à l’autre est plus importante que ses propres principes. C’est vrai dans la vie spirituelle, c’est vrai dans la vie de famille aussi ainsi que le disait une fois un jeune parent : « Avant, j’avais des principes... maintenant, j’ai des enfants. ». L’amour, l’attention à l’autre, peut parfois nous amener à réviser nos certitudes. Et c’est une bonne chose.
Mais cela ne signifie pas qu’il faille se dissoudre dans le monde. Être dans le monde ne veut pas dire en épouser toutes ses logiques. Le monde est souvent régi par des lois d’égoïsme, de matérialisme, de quête de pouvoir ou de vengeance. L’Évangile, lui, nous appelle à une autre logique qui fait de nous des êtres un peu étrangers au monde. Ctte tension qui traverse toute la vie chrétienne : être dans le monde, sans être du monde. C’est une dialectique délicate, mais essentielle bien exprimée par la prière dite « sacerdotale » de Jésus en Jean 17, où il dit à Dieu à propos de ses disciples : « Je ne te prie pas de les retirer du monde, mais de les garder du mal. ». Voilà la vocation du croyant : vivre pleinement dans le monde, sans fuir, sans se replier — mais aussi sans se laisser absorber, sans perdre son âme. Être là, au cœur du monde, pour y vivre en fidélité.
La fécondité de la relation
Le texte poursuit en disant : « Au petit matin, nous irons dans les vignes, voir si la vigne bourgeonne, si la fleur s’ouvre ». Dans la Bible, la vigne occupe une place centrale., elle produit du vin, qui, lorsqu’il est consommé avec modération, est symbole de la joie et de la fête, de célébration et de bonheur partagé, un peu comme le champagne pour nous aujourd’hui. Ainsi, aller dans les vignes, c’est entrer dans un espace de promesse de joie. Peut-être est-ce là notre première vocation : chercher la joie pour la partager. Travailler à ce que le monde ait des raisons de se réjouir. Nous avons tous cette responsabilité, aussi humble soit-elle : nous demander chaque jour comment, par nos gestes, nos paroles, notre présence, nous pouvons apporter un peu de bonheur, un peu de lumière, à ceux qui croisent notre chemin.
Le verset dit aussi : « Nous irons ». Ce « nous » est essentiel : dans le cadre d’un couple, cela rappelle que l’on ne fait pas route chacun de son côté, on y va ensemble, on se soutient, on avance à deux, on partage les joies comme les efforts. Dans la lecture spirituelle, ce « nous » indique que Dieu et l’homme marchent ensemble. Il ne s’agit pas de dire à Dieu : « Seigneur, fais quelque chose, donne un peu de joie au monde », ni de se dire à soi-même : « C’est à moi, seul, de tout porter. » Non. Il y a là une alliance, une synergie, c’est en agissant ensemble, Dieu et nous, que de grandes choses peuvent advenir. Ensemble, nous allons dans les vignes. Ensemble, nous cherchons les signes de vie, les premiers bourgeons de la joie pour ensuite les partager
Et puis, il y a cette précision : « Au petit matin ». Il ne s’agit pas tellement d’une question d’horaire. Le matin, dans la Bible, c’est souvent le temps des priorités, le commencement, le moment où l’on met ce qui compte vraiment à la première place. Cela pose une question essentielle : quelle est la première chose que je mets dans ma journée, dans ma vie ? Voici la meilleure réponse : « Comment puis-je être source de joie aujourd’hui ? »
Cependant, le texte ne parle pas de vin prêt à être bu, ni de vendanges abondantes. Il ne dit pas : « Allons récolter les grappes mûres » mais : « Allons voir si la vigne bourgeonne ». Cette nuance est très importante. Il ne s’agit pas de résultats immédiats, mais de signes naissants. Ce que je peux faire n’est pas forcément de produire de la joie toute faite, emballée et prête à consommer, mais de créer les conditions où quelque chose pourrait éclore. Aller dans la vigne, veiller, observer, prendre soin, espérer, favoriser les bourgeons, ces signes encore fragiles d’une joie à venir.
Voilà qui est libérateur, sinon, je pourrais vite me sentir jugé, sommé de rendre des comptes : « As-tu suffisamment donné de joie au monde ? » Et je serais bien obligé de répondre : « Seigneur, j’essaie, mais… ce n’est pas si simple. ». Or Dieu ne nous demande pas d’apporter la joie parfaite. Il nous invite à aller dans la vigne, à voir si elle bourgeonne. À faire ce premier pas, à amorcer un processus.
Et si l’on veut aller encore plus loin dans la lecture spirituelle, le vin, bien sûr, renvoie aussi au sang du Christ. Il est au cœur de la communion. Il évoque non seulement la joie humaine, mais aussi la joie spirituelle, celle qui nous unit à Dieu dans l’amour, dans le don, dans l’alliance. C’est ce que je ressens très concrètement, par exemple, quand je fais du catéchisme avec les enfants. Est-ce que j’arrive à leur transmettre toute la foi, toute la profondeur de l’Évangile ? Non, évidemment. Mais si, à la fin du parcours, il y a un petit bourgeon qui pointe, une graine qui commence à germer, alors je rends grâce. Le fruit viendra peut-être plus tard, ou peut-être pas. Mais j’aurai essayé de prendre soin de la vigne. Je ne peux ni forcer, ni imposer. Ni la foi, ni la joie, ni rien de ce qui est profond ne peut être contraint. Tout ce que je peux faire, c’est accompagner, être là, présent dans la vigne, et espérer que quelque chose s’épanouisse.
Qui aime qui ?
Et là, le texte dit : « Là, je te donnerai mes amours ». Ainsi, après avoir tant insisté sur notre action dans le monde, sur le fait d’aller, de donner, de rayonner, surgit ici l’essentiel : l’amour que l’on porte à Dieu. Le mot « amour » est ici au pluriel, parce que donner et transmettre, c’est donner de l’amour (aux autres), et c’est aussi aimer Dieu. L’amour n’est jamais simple, il ne peut être seulement d’aimer son prochain ou d’aimer Dieu, les deux sont liés. L’amour de Dieu pour nous est fondamental, mais il est tout aussi structurant de pouvoir dire : « Moi aussi, j’aime Dieu. ». Beaucoup de chrétiens répètent souvent : « Dieu vous aime. » ou « Jésus t’aime. » Et c’est vrai, c’est merveilleux. Mais ne devrait-on pas dire aussi : « Aime Jésus » ? Aimer Dieu, se tourner librement vers une réalité qui nous dépasse, qui nous accueille, qui nous soutient — cela structure une vie, cela sauve une vie.
Et puis, le mot hébreu utilisé ici pour désigner les « amours » est « dodayim », qui peut désigner « les amours », mais aussi « les seins », « les mamelles ». C’est d’ailleurs ainsi que la version grecque de la Septante (datant d’environ 300 avant Jésus-Christ) l’a traduit : « je te donnerai mes seins. » Cela peut surprendre, mais dans la langue hébraïque, le vocabulaire du corps et celui de l’affection sont souvent étroitement liés. Cette traduction-là ouvre une autre lecture : donner de l’amour, c’est aussi offrir sa capacité de nourrir, de transmettre. Ainsi le croyant s’offre disponible pour nourrir le monde, pour le servir, il offre sa capacité à se donner lui-même, et devenir une source de vie pour d’autres.
Le saint esprit
Et puis arrive l’un des éléments les plus mystérieux de notre passage : les mandragores. Il est écrit : « Les mandragores ont donné leur odeur, et nous avons à nos portes tous les fruits exquis, les anciens et les récents.».
Les mandragores… Que sont-elles ? Et surtout, que donnent-elles vraiment ? Le texte nous dit que ces mandragores donnent un parfum agréable, mais c’est plus que cela, parce qu’en hébreu, le mot pour odeur (« reah ») est le même que celui qui dit le « souffle », proche de « rouah » qui désigne à la fois le vent, le souffle vital… et l’Esprit de Dieu.
Ainsi, les mandragores donnent plus qu’un parfum : elles donnent le souffle, elles donnent l’Esprit. Et là, dans ce texte poétique et amoureux, arrive soudain une dimension nouvelle, spirituelle au plus haut point : la présence du Saint-Esprit. Nous avions déjà l’amour, la joie, la relation, la mission, la fécondité… Et voici maintenant l’Esprit, comme un hôte discret mais essentiel, qui entre dans la scène. Et cela est très réjouissant.
Les mandragores
Mais que sont donc ces mandragores ? En vérité, on ne le sait pas vraiment.
Le mot hébreu utilisé ici est « doudaïm », un terme rare, difficile à traduire avec certitude. La tradition a retenu « mandragores », pour des raisons que nous allons voir, mais littéralement, « doudaïm » signifie normalement des corbeilles, ou des paniers. Ce qui, avouons-le, rendrait le verset plutôt étrange : « Les corbeilles donnent leur odeur… » ce qui n’est pas très clair.
Et c’est là que commence le travail d’interprétation, un peu comme un petit trésor d’exégèse à déchiffrer. Ce mot « doudaïm », on ne le trouve qu’à deux autres endroits dans l’Ancien Testament ainsi au pluriel. C’est très peu. Ce mot rare nous laisse donc dans une certaine incertitude, et peut-être est-ce volontaire. Peut-être que cette obscurité fait partie du mystère du texte : une invitation à accueillir ce que l’on ne comprend pas tout à fait, à respirer ce souffle invisible, à laisser l’Esprit parler là où les mots ne suffisent plus. Cette image des mandragores — ou des paniers — qui donnent leur odeur, leur souffle, est comme un dernier cadeau du texte : une ouverture vers le mystère de la présence divine. Quelque chose de fragile, de discret, d’indéfinissable, mais qui pourtant emplit l’air, porte la vie, et révèle la profondeur du lien entre le visible et l’invisible.
Les deux paniers de Jérémie
Ces « doudaïm » apparaissent dans Jérémie 24, aux versets 1 et 2. Le texte dit ceci : « Voici, il y avait deux paniers de figues placés devant le temple de l'Éternel. L’un contenait de très bonnes figues, comme celles qui mûrissent les premières ; l’autre, des figues très mauvaises, si mauvaises qu’on ne pouvait les manger. » Ce sont là donc deux paniers, l’un qui exhale une bonne odeur, et l’autre… une odeur bien moins agréable. Quand le Cantique des Cantiques nous dit : « Les mandragores donnent leur odeur », à la lumière de Jérémie on peut ainsi penser qu’il y comme deux paniers, un de bonne odeur et l’autre de mauvaise odeur. Or, voilà qui me ressemble... Si je me retourne sur ma propre vie, ma vocation, mon parcours… ai-je toujours été porteur d’une bonne odeur ? Ai-je toujours été, pour ceux qui m’entourent, un panier rempli de figues savoureuses, prêtes à réjouir les cœurs ? Bien sûr que non ! Ai-je toujours offert le meilleur de moi-même à mon épouse ? Non. Ai-je été un père parfait, ne transmettant que le bon à mes enfants ? Hélas, non plus. Et pour mes paroissiens, mes catéchumènes, ceux que j’ai rencontrés en Église, ai-je toujours été une odeur de sainteté, une présence réconfortante et inspirante ? Certainement pas.
Et pourtant — et c’est cela qui me touche dans ce passage — rien de ce qui a été dit avant dans le texte n’est annulé par cette réalité ambivalente. Il y a cette tension entre le bien et le moins bien, entre ce qui sent bon et ce qui sent mauvais, mais malgré cela, l’amour est toujours là. L’appel, la vocation, la fécondité, la joie, la mission... tout cela reste vrai, valable, possible. Dans ma vie, comme dans la vôtre, comme dans toute vie humaine, il y a un mélange de bon et de mauvais, de bonnes et de mauvaises figues, et pourtant, le texte dit : « Nous avons à nos portes tous les fruits exquis, les anciens et les récents. ». C’est-à-dire que malgré nos limites, malgré nos échecs ou nos failles, quelque chose de bon peut encore être offert, peut encore surgir. Ces fruits exquis sont là, à notre porte, il y a eu du bien qui a été donné, et il y en aura encore. C’est cela qui compte.
Et le plus précieux, le plus fécond, le plus profond… il vient peut-être justement maintenant.
Le mystérieux cadeau de fécondité de Léa
L’autre occurrence du mot « doudaïm » dans l’Ancien Testament se trouve dans Genèse 30 (v.14), dans un épisode complexe de la vie de Jacob. Jacob avait deux épouses : Léa et Rachel. Léa, la moins aimée, avait cessé d’enfanter, mais elle désirait ardemment donner encore un enfant à Jacob. Léa offre à sa sœur Rachel… quelque chose et elle pourra s’unie à Jacob et enfanter encore. Le texte utilise une fois de plus ce mot « doudaïm, » dont nous ne savons toujours pas exactement ce qu’il désigne. Est-ce un panier ? Une plante ? Une racine ? La tradition grecque, via la Septante, avait traduit ici « doudaïm » par « mandragoraï » : des mandragores, et l’idée est restée dans nos traductions françaises.
Pourquoi ? Sans doute parce que, dans l’Antiquité, la mandragore était réputée pour ses vertus aphrodisiaques. Théophraste, entre autres auteurs anciens, évoquait cette plante fascinante dont la racine ressemblait à un petit corps humain — un homoncule. On lui prêtait des pouvoirs mystérieux, notamment en lien avec la fécondité, Elle avait la réputation d’être aphrodisiaque, sans doute parce que sa racine contient des alcaloïdes psychotropes. On s’en servait pour faire des potions, des filtres d’amour, des remèdes...
Mais ce qui m’intéresse ici, c’est que ce mot, qu’on traduit par « mandragore » dans le Cantique des cantiques, apparaît dans une histoire qui parle d’union, de désir, de fécondité. Exactement comme dans notre livre. Ce n’est donc pas un hasard si les anciens traducteurs ont fait ce choix. La mandragore, dans cette tradition, évoque ce qui permet à quelque chose de naître. Ce qui rend possible une descendance, une suite, une postérité.
Et ainsi, quand le texte du Cantique dit : « Les mandragores donnent leur odeur », on comprend qu’il y a là une promesse : une fécondité devient possible. Après tout ce parcours, toute cette ouverture, ce don de soi, cette marche dans les champs, cette attention à la vigne… quelque chose va pouvoir naître. Quelque chose que l’on pourra laisser derrière soi. Quelque chose qui nous survivra. Et sans doute le but ultime : ne pas vivre pour soi-même, mais transmettre. Laisser une trace. Offrir une postérité, pas seulement biologique, bien sûr, mais spirituelle, affective, humaine. Qu’est-ce que je donne au monde ? Qu’est-ce que je laisse ? Quelle semence ai-je plantée ?
Et cette mandragore, dans l’histoire de Jacob, il faut la donner. C’est à l’inverse de ce que l’on pourrait penser, c’est Léa donne la mandragore à Rachel et c’est celle qui s’en sépare qui enfantera ! Cela qui implique une perte, un renoncement, un geste de générosité. On ne peut pas garder pour soi ce qui rend fécond. Pour qu’il y ait transmission, pour qu’il y ait naissance, il faut accepter de donner. Peut-être même de se séparer de quelque chose de précieux. Il n’y a pas de fécondité sans offrande. Voici la question que chacun doit se poser sans cesse : Et moi, qu’est-ce que je donne ?
L’amour, toujours l’amour.
Et c’est là que cela devient encore plus beau. Parce que « doudaïm » est encore presque le même mot que nous avions au départ « dodaïm » qui signifiaient les amours, ou les seins. Mandragore, panier, sein, amour… tous ces mots, en hébreu, tournent autour de la même racine, de la même idée. « Dod », c’est l’amour, ici au toujours au pluriel. L’amour avons-nous déjà dit n’est jamais simple. Il est multiple. Il est fait de ce que je donne, de ce que je reçois, et aussi de ce que nous donnons ensemble. Dans un couple, c’est l’amour réciproque et commun. Dans la foi, c’est l’amour de Dieu pour moi, qui est premier, (« Nous aimons, parce que Dieu nous a aimés le premier ») et le mien pour Dieu. Ce sont déjà deux amours. Et puis il y a l’amour du prochain. Deux amours que Jésus réunit en un seul commandement. « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur… et ton prochain comme toi-même. » Pour le Christ, ces deux commandements sont le même. Ils ne s’opposent pas. Ils se rejoignent.
C’est ce double amour — pour Dieu et pour l’autre — qui donne, au fond, la bonne odeur. Celle du souffle. Celle de l’Esprit. Et c’est pour cela que ce verset si mystérieux est si important : en trois mots, on y trouve les trois éléments les plus essentiels de la vie : l’amour, l’esprit et le don. C’est la base de tout.
Les fruits de l’ouverture
Et finalement, le chapitre se conclut ainsi : « Nous avons à nos portes tous les fruits exquis, les nouveaux comme les anciens. Et je les ai réservés pour toi ». Cette image des portes est magnifique. D’abord parce qu’en réalité, le mot hébreu ne signifie pas littéralement « porte », mais plutôt « ouverture ». Dans les ouvertures, dit le texte, se trouvent les meilleurs fruits. Une ouverture, comme une porte, est un lieu de passage, un lieu de circulation. Elle permet de sortir — sortir de soi, sortir de ses enfermements, de son égoïsme, de son intégrisme. Elle permet aussi d’entrer — accueillir l’autre, recevoir l’inattendu, s’ouvrir à ce qui vient. C’est peut-être là que se joue le sens même de notre vie : dans cette capacité à s’ouvrir, à ne pas se refermer. Les meilleurs fruits — les plus exquis, dit le texte — ne sont pas cachés dans un coffre-fort. Ils sont à la porte. Là où quelque chose s’ouvre. Là où la vie passe, entre et sort, comme un souffle.
Ouvrir sa porte, ouvrir son cœur, c’est toujours prendre un risque. Une porte ouverte, c’est une possibilité d’intrusion, il peut y entrer de l’imprévu, de l’indésirable. Mais c’est le prix de l’amour véritable : ce risque d’être touché, bouleversé, blessé même, est aussi la possibilité d’être fécondé, transformé, comblé. Et c’est dans cette ouverture que se trouvent tous les meilleurs fruits, nous dit le texte, les nouveaux certes, mais aussi les anciens. Parce que dans la vie spirituelle, rien n’est jamais perdu. Le bien que nous avons fait, les fruits que nous avons portés, même si nous les avons oubliés ou sous-estimés… ils sont toujours là. Conservés. Mis de côté, réservés, pour quelqu’un. Pour Dieu, peut-être. Ou pour celui ou celle qui viendra ensuite. Ou simplement pour la vie. Rien de bon n’est jamais perdu. Il y a dans cette fidélité une mémoire de Dieu que nous n’avons pas toujours nous-mêmes. Une promesse que le fruit ancien comme le fruit nouveau a sa place.
Cela fait penser à ce que Paul écrit dans ce chapitre si souvent lu lors des mariages en I Corinthiens 13 : « Maintenant donc ces trois choses demeurent : la foi, l’espérance et l’amour. Mais la plus grande des trois, c’est l’amour. » Tout le reste passera. Les paroles, les actes, les gestes… mais l’amour, lui, demeure. Il est le fruit qui ne pourrit pas. Il est le trésor éternel. Et ce texte du Cantique des Cantiques ne fait que le confirmer : tout au long de ces versets, nous avons suivi un chemin de relation, de désir, de mission, de fécondité, de souffle, d’espérance… et tout cela s’achève dans l’amour.
L’amour comme programme, l’amour comme bonne nouvelle. Accueil inconditionnel qui est fait d'esprit, de don, de fécondité et de joie
Amen.